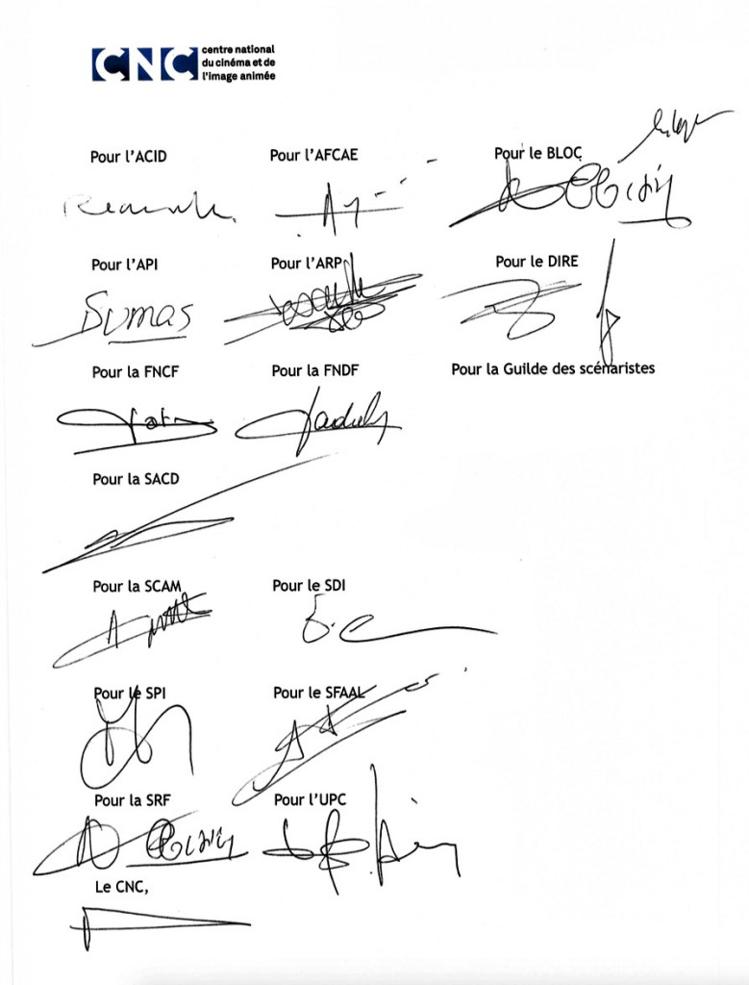La Quatrième Voie de Gurvinder Singh, avec Suvinder Vikky, Rajbir Kaur, Gurpreet Bhangu, Taranjeet Singh. Durée: 1h55. Sortie le 8 juin 2016
Nous voyons ces deux hommes. Nous ne savons rien d’eux. Ils ne parlent pas. Ils traversent en bus une ville inconnue, puis continuent à pied. Ils sont pressés. Rien de ce que nous percevons, image et sons, n’apporte d’information, sinon qu’on est « en Inde ». En prélude, un carton a mentionné l’Etat du Pendjab en 1984, moment de graves troubles où les Sikhs, majoritaires dans la région, affrontent la police et l’armée, qui détruit le lieu saint, le Temple d’or d’Amritsar, ce qui entrainera quelques mois plus tard l’assassinat d’Indira Gandhi par ses gardes sikhs. Ce sont des informations générales, impossibles à utiliser en relation avec ce qu’on voit à l’écran, en tout cas par qui ne connaît pas bien le pays et son histoire.
Les deux hommes arrivent dans une gare. Ils veulent aller à Amritsar, attendent longuement un train, sont rejoints pas trois autres que leur turban et leur barbe aident à identifier comme Sikhs. Ils ont la même destination. Lorsqu’un train arrive enfin, il leur est interdit à tous d’y monter, mais ils s’y installent en forçant le passage. Dans le fourgon se trouvent d’autres hommes, sikhs également.
L’histoire contée par le film n’est pas commencée. Elle ne se passe pas à ce moment-là ni à cet endroit-là (durant le voyage en train) mais « quelques mois plus tôt » (nouveau carton), dans une ferme et ses environs, campagne et village. Ce qui est bel et bien commencé, et de très appétissante façon, c’est la manière de filmer de Gurvinder Singh, et ce qu’elle engendre.
Les plans séquences, l’attention aux visages et aux gestes, la capacité à accueillir des atmosphères sans les assigner à une signification ou à une symbolique établissent une écriture ouverte, à la fois suggestive et intrigante. D’autant plus intrigante pour un spectateur occidental – et c’est en l’occurrence un véritable bienfait, dès lors qu’on accepte d’accompagner ce qui ne sera jamais ni expliqué par un commentaire (verbal ou visuel), ni assigné à un enchainement narratif.
La Quatrième Voie, dont le titre est lui aussi énigmatique, mobilise le vocabulaire du cinéma fantastique, parfois du film d’horreur, parfois du pamphlet politique, du film d’action, de la comédie, de la chronique sociale, du poème visuel. Il faut un certain temps pour se faire à l’idée que jamais une de ces modalités ne prendra le pas sur les autres. L’interminable débat sur l’exotisme, sur le fait de faire là-bas des films vus ici, trouve ici une réponse singulièrement heureuse, par la manière dont le cinéaste – qui connait fort bien le vocabulaire et l’histoire de l’art du cinéma – choisit de ne pas se soucier d’autres critères que ceux qui régissent le monde où se passe son film.
La famille sikhe au centre du récit, ses démêlés avec les militants en armes, avec les soldats, avec les leaders du village, le sort devenu central du chien de la maison, la beauté fascinante des plans de nature, les dilemmes du père de famille, la peinture des mœurs rurales… ce sont autant de composants, qui s’assemblent selon des logiques inédites, des compositions singulières où le suspens, jusqu’à l’extrême bord d’un gouffre de terreur, la violence, le quotidien débonnaire, affectueux, le souffle lointain, puis soudain proche, de l’actualité politique de la région, fabriquent un monde aux règles inusitées.
Gurvinder Singh a le grand mérite de ne pas filmer pour des spectateurs occidentaux, il travaille de l’intérieur un monde qu’il connaît bien. Et ce double mouvement – proximité entre le film, le sujet, les protagonistes et l’auteur/éloignement pour un public européen – augmente la puissance de suggestion des plans, les ressources poétiques de leur assemblage.
C’est peu de dire que cela ne va pas de soi, la même configuration pourrait produire un résultat incompréhensible, ou de piètre intérêt. Assurément le sens du cadre et de l’image est ici d’un grand recours, et la manière d’utiliser notamment l’obscurité, les basses lumières, la brume, paradoxalement augmente un autre accès au film, aux émotions et aux idées qui l’animent.
Mais il y a davantage, même si cela est difficile à formuler. Disons : un sentiment du monde. Car il s’agit à la fois d’événements politiques très précisément situés, de grandes questions (les minorités, les inégalités, la situation agraire, la lutte armée, le comportement des autorités et des forces de l’ordre) toujours actives dans la société indienne, et d’une parabole universelle. L’élégance attentive de la mise en scène en même temps que sa volonté de ne pas se soumettre à un récit, encore moins à une démonstration, délient les puissances qui habitent ce film, film qui se révèle extrêmement ambitieux malgré son apparente modestie.
On remarquera aussi que c’est le deuxième film indien en quelques semaines, après le déjà remarquable mais tout à fait différent Court de Chaitanya Tamhane, qui témoigne de l’apparition d’une nouvelle génération de réalisateurs dans ce pays, riche des plus hautes promesses.
lire le billet